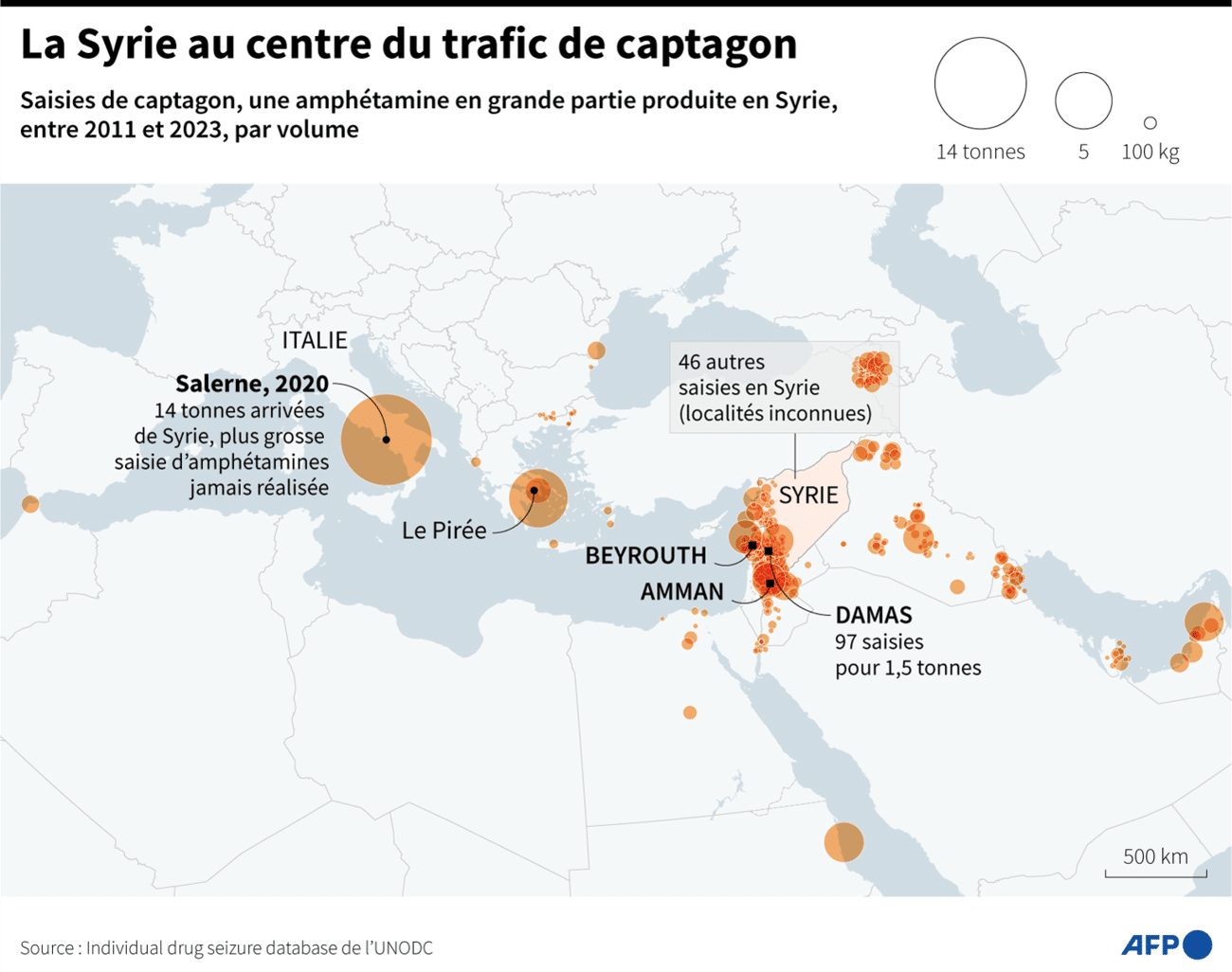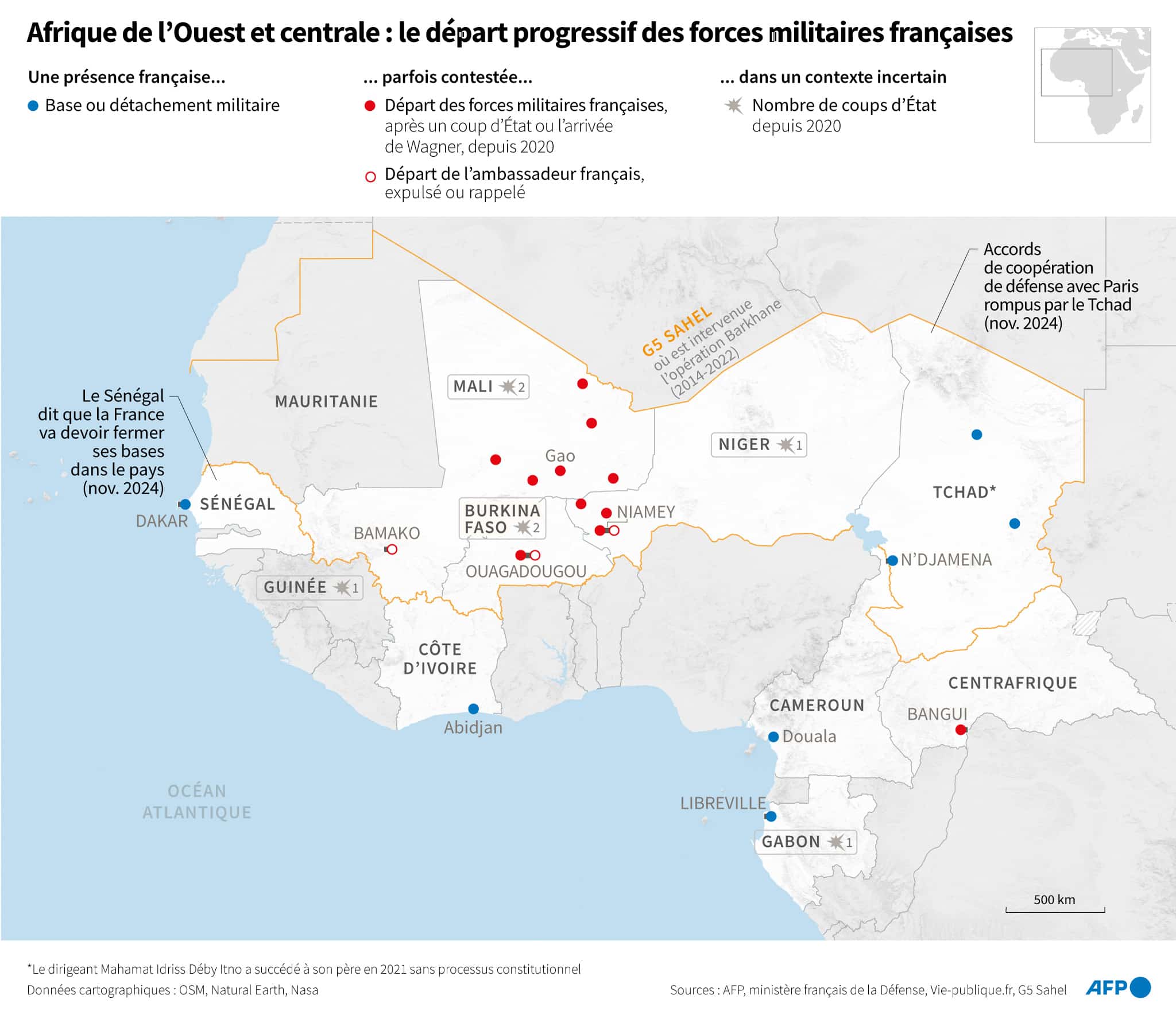L’islamisme aurait-il remplacé le communisme comme nouvel ennemi ? C’est l’idée régulièrement assénée, mais que l’étude de la genèse du mouvement djihadiste tend à relativiser.
Dans ses travaux sur Le nouveau jihad en Occident, le sociologue Farhad Khosrokhavar définit le jihadisme comme un phénomène politico-religieux où des acteurs combinent une version extrémiste de l’islam qui met le Jihad, guerre sainte, au centre de leurs préoccupations, avec une action violente qui se veut l’expression de ce jihad[1]. Quant à l’islamisme, il s’agit d’un mouvement politico-religieux qui prône l’application des principes et des valeurs de l’islam comme référent et cadre organisationnel des sociétés. Théorisé à la fin des années 1920 en Égypte, il est principalement représenté par les Frères musulmans. Leur objectif principal est l’émancipation vis-à-vis de l’Occident. Pour Philippe Henri Gunet, « l’islam est son vecteur d’expression parce qu’il est un référentiel identitaire que ce dernier n’a pas réussi à « coloniser ». Il n’est pas la finalité du mouvement, il n’est pas son pourquoi, mais son comment. L’islam politique ne cherche d’ailleurs pas à propager une forme particulière de l’islam ; ce n’est pas sa raison d’être. »[2] À côté des Fréristes, le salafisme vient compléter le panel de l’islamisme.
Retrouvez le hors-série de Conflits « Regards sur la guerre » dans notre boutique en ligne.
Mouvement sunnite dont les racines renvoient à l’islam du IXe siècle, il incarne un islam rigoriste. Le wahhabisme d’Arabie saoudite en est la principale émanation. Face à ce mot qui se décline finalement en une myriade de courants aux modalités d’action et aux stratégies très diverses, la guerre que G.W. Bush a lancé en la qualifiant en 2001 par l’acronyme GWOT, Global War On Terrorism, confronte la réflexion stratégique à un phénomène particulièrement complexe. La première et principale conséquence de la croissance conjointe du jihadisme et de l’islamisme est le développement d’une islamophobie primaire dans la plupart des pays européens. Parce que nous sommes collectivement incapables d’analyser méthodologiquement un phénomène qui se décline à différentes échelles, locales-régionales et internationales, journalistes, intellectuels et autres partis politiques à tendances populistes réduisent analytiquement leur champ de vision à des explications mono-causales et idéologiques.
À lire également
Fenêtre sur le monde. Le djihadisme d’atmosphère. Gilles Kepel
Avec le jihadisme, les sociétés modernes occidentales font donc face d’une part à un retour à l’obscurantisme et, d’autre part voient les normes démocratiques mises à mal. Soudain, les fondements du vivre ensemble adoptés par l’homo occidentalus et portés par la sanctuarisation de la non-violence, de la tolérance, du féminisme, de la liberté sexuelle comme des droits LGBT viennent se heurter à un homo islamicus qui incarnerait l’esthétique de la violence, mettant en scène la mort tout en propageant un discours apocalyptique. Depuis le mois de janvier 2015, après chaque attentat jihadiste, la même rengaine journalistique et institutionnelle revient. Il s’agit d’imposer un nouveau credo : « Ils s’attaquent à nos valeurs, à la démocratie, à nos libertés ». Avec un tel narratif, la dialectique de la guerre « Même-Autre » s’enferre dans une dimension exclusivement idéologique : valeurs dites occidentales versus idéologie islamiste. Or, dans cette GWOT qui fait rage depuis bientôt deux décennies, il ne faudrait pas se limiter à un regard occidentalo-centré. Grâce au diapolème de la terreur, revenons à la dimension humaine et tellurique afin d’inverser à nouveau notre regard. En effet, un cruel bilan humain de cette guerre montre que pour 1000 victimes en Orient il y en a une seule en Occident[3]. Ce fait statistique terriblement cynique n’a pas pour but de relativiser la dimension du problème, mais de poser une question déterminante. En quoi l’ensemble des manifestations mortifères du jihadisme et de l’islamisme en Irak, en Syrie, en Arabie saoudite, dans les autres pays arabo-musulmans comme dans la bande sahélo-saharienne, représentent-elles des attaques contre les « valeurs » de liberté et de démocratie ? Est-on alors capable d’établir le bon diagnostic de cette guerre si l’on est toujours incapable de questionner la part de responsabilité des pays occidentaux dans le développement endémique du jihadisme et de l’islamisme en terre d’islam, et ses connexions avec nos nouvelles formes d’urbanités (banlieues, quartiers « banlieusardisés », centres-villes appauvris, France périphérique…) ? L’islamisme et le jihadisme s’attaquent-ils aux valeurs dites démocratiques actuelles (le pourquoi, qui détermine les fondements de la démocratie) ou à la manière dont elles sont appliquées dans nos espaces publics et imposées à l’Empire monde (le comment, qui en exprime ses manifestations actuelles) ?
Dans cette nouvelle forme de guerre, l’erreur du diagnostic stratégique fait que l’ennemi revêt une nature exclusivement morale dans la mesure où il perturbe la vision économico-culturelle (le néolibéralisme) que l’hégémon aimerait imposer à la planète Terre. En effet, en dissociant l’élément politique de l’économique et en faisant primer ce dernier sur le premier la logique de l’hégémon devient cujus economica ejus regio[4]. Une telle vision idéologique du monde donne ainsi corps à un Système-monde monothéiste, à dimension quasi théologique. Cet Empire imprudent qui se veut « arbitre de la Terre » en s’engageant dans des contrées désertiques renvoie le lecteur à interroger le modèle médiéval présenté précédemment. En effet, au cœur de la Respublica christiana, la guerre revêt une dimension théologique dans la mesure où c’est le pouvoir de l’Église qui désigne l’ennemi réel. L’ennemi, hostes perpetui[5], est la personne qui ne reconnaît pas le pouvoir spirituel de l’Église, le Turc, l’Arabe ou le Juif par exemple. Cependant, si au Moyen-Âge la figure de l’ennemi était un être immoral, il est aujourd’hui reconnu comme un ennemi illégitime. Tel est campée l’idée force de Carl Schmitt dans Le Nomos de la Terre[6], qui définit la transition entre le monde médiéval et le monde moderne comme la renaissance d’un monde se restructurant autour de la déthéologisation de la vie sociale et de l’abandon du concept de justa causa au profit de celui de justus hostis. Il écrit en ce sens : « on détache définitivement l’argumentation théologico-morale de l’Église de l’argumentation juridique de l’État. Et, chose tout aussi importante, on sépare le problème de la justa causa, qui relève du droit naturel et de la morale, du problème typiquement juridique et formel du justus hostis, distingué, objet d’une action punitive. »[7] Ainsi, pour l’auteur qui épouse l’analyse du juriste catholique allemand, seul l’ennemi est désormais criminel. Cette acception est remarquablement formulée par « la guerre elle-même devient un crime dans l’acception pénale du mot »[8]. Aussi, Slobodan Milosevic, Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, Oussama Ben Laden, Ahmad al-Bahrani ou encore Kassem Soleimani sont-ils devenus des criminels que l’on se doit de supprimer sans jugement[9]. Targetted killing and Kill list !? Et le type de guerre que l’hégémon conduit pour les exécuter n’a véritablement pour principal vecteur que la frappe chirurgicale. Est-ce donc encore une guerre ?
À la lueur des interventions initiées par le gouvernement américain depuis les 73 jours de bombardements aériens de l’OTAN contre la Serbie en 1999, la nouvelle tendance de la guerre se caractérise par son travestissement en opération de police internationale. Schmitt a la prescience d’appréhender cette transformation dès la mise en œuvre du traité de Versailles[10] lorsqu’il écrit : « L’action menée contre lui [l’ennemi] n’est pas davantage une guerre que ne l’est l’action de la police étatique contre un gangster : c’est une simple exécution et, en fin de compte, du fait de la transformation moderne du droit pénal en lutte contre les nuisances sociales, ce n’est qu’une mesure contre un agent qui nuit ou qui dérange, contre un perturbateur qui est mis hors d’état de nuire avec tous les moyens de la technique moderne, par exemple une police bombing.[11]» Cette mutation de la guerre voit deux entités s’affronter, profondément étrangères l’une à l’autre, tant d’un point de vue moral que juridique. Cependant, si la guerre policière conduite par l’hégémon ne semble pas avoir une véritable stratégie, l’État islamique en développe probablement une. La nébuleuse Daech possède une pensée stratégique propre. L’auteur la qualifie de stratégie glocale[12]. D’abord au niveau local, c’est-à-dire en conduisant une guerre de type classique qui a une dimension territoriale (Irak et Syrie) et militaire régionale, car elle implique des acteurs prépondérants comme la Turquie et la Russie ou encore l’Iran. Affrontement armé classique depuis l’apogée de Daech en 2014, il est entré dans une nouvelle phase depuis le mois de mars 2019, lorsque les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis ont repris le dernier territoire syrien encore tenu par l’État islamique. Concomitamment à cette dimension moyen-orientale, il faut rappeler ici que la stratégie de l’État islamique se veut un retour au califat historique, porté par un dessein théologique. « Le califat apporte une solution globale : une seule communauté, une seule loi, un seul chef… »[13]. Sa globalisation que cherche l’islamisation s’exprime de facto par un modus operandi bien connu. Il s’agit du terrorisme de masse qui déterritorialise un État islamique désormais devenu une idéologie sans État. Il endeuille la France comme d’autres pays européens et fait vivre tous les pays impliqués dans la lutte au rythme des attentats comme dans une paranoïa qui serait liée aux vagues de migrants incarnant une possible Cinquième colonne islamiste.
À lire également
Évolution du djihadisme et du terrorisme au Sahel depuis vingt ans
Dès lors, Daech et ses avatars deviennent l’incarnation du règne de la peur. Le point faible de nos sociétés se trouvant dans le psychisme, la pertinence de leur stratégie repose sur l’exploitation de la faiblesse psychique, grâce au règne de la terreur. C’est la guerre à domicile ou une guerre domestique, une guerre dans le tissu urbain et social. Mais la société, comme la force publique, n’a-t-elle pas déjà longuement incubé dans sa chair les métastases stratégiques du Califat 2.0 ? L’assassinat le 3 octobre 2019 de quatre fonctionnaires de police par l’un de leurs collègues, au cœur de la Préfecture de police de Paris, n’en est-il pas déjà les prémices ? Le modus operandi choisi par Daech conduit à une comparaison pourtant improbable. Le Général Raoul Salan, officier qui en son temps fut le plus décoré de l’armée française, qui depuis sa sortie de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1917 consacra toute sa carrière à l’Indochine puis à la guerre coloniale, qui dirigea la commission d’enquête sur la chute du camp retranché de Diên Biên Phu avant de commander en chef les départements français d’Algérie confrontés à une autre guerre insurrectionnelle, devint l’incarnation même de la figure de la terreur lorsque dans la nuit du 25 avril 1961 il rejoint l’Organisation de l’Armée Secrète[14] (OAS). En entrant dans la clandestinité, il épousait alors une stratégie qu’il avait combattue toute sa vie[15]. Alors qu’il est commandant supérieur interarmées en Algérie, l’épisode de la bataille d’Alger (7 janvier-8 octobre 1957), , pourrait être analysé comme la première manifestation d’un jihad « canal historique ». Pour les jeunes Français qui y aspirent aujourd’hui, cela devient leur exemple et une référence. Ainsi, le transfert cognitif dont Salan est l’objet est particulièrement intéressant. Il a laissé un slogan-graffiti ornant les murs d’Alger, d’Oran ou encore de Constantine : « L’OAS frappe où elle veut, qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut… » A contrario de l’OAS, qui exprimait les soubresauts des derniers défenseurs d’un empire devenu indéfendable et qui finit par s’éteindre rapidement, Daech et ses épigones donnent corps à une armée impalpable et sécable, multitude de combattants invisibles. Ils se répandent insidieusement dans l’espace et dans le temps. De l’action spectaculaire sur les Twin towers à la multiplication chronique des attentats perpétrés hier par Al-Qaida et aujourd’hui par Daech, la terreur est devenue une technique commune aux deux partis en guerre. Est-elle pour autant un moyen ou une fin ? Et d’ailleurs, après avoir cherché à redéfinir la guerre en plaçant le verbe « dominer » en son centre, cette nouvelle guerre que l’on s’évertue à qualifier ne peut-elle pas également s’inscrire dans une grille d’analyse crypto-marxiste, « dominants-dominés » ?
Notes
[1] Farhad Khosrokhavar, Le nouveau jihad en Occident, Robert Laffont, Paris, 2018, p.15.
[2] Philippe Henri Gunet, La démocratie première victime de la guerre contre l’islam politique, étude publiée sur le blog Orient XXI.
[3] Philippe Henri Gunet, Tant que l’Occident fabriquera des terroristes, il y aura des attentats, étude publiée sur le blog Orient XXI. Il écrit dans l’introduction de cette étude : « La « guerre contre le terrorisme » initiée par Georges W.Bush a fait entre 500 000 et un million de victimes, même si elle a aussi et surtout servi de prétexte aux ambitions idéologiques et économiques des néoconservateurs Américains alors au pouvoir. Depuis cette date également, on dénombre 544 décès en Europe par attentats djihadistes et 111 aux États-Unis, soit un total de 655. C’est-à-dire que pour 1 000 victimes de cette guerre en Orient, dont quelques-unes seulement sont des djihadistes, il y a une victime en Occident. »
[4] L’adage « Telle économie, tel Prince » formule le principe directeur suivant lequel la caractéristique économique d’un peuple serait nécessairement celui de l’hégémon.
[5] Schmitt, opus cité, p.133.
[6] Carl Schmitt, Le Nomos de la terre dans le droit des gens du jus publicum europaeum, PUF, collection Quadrige, 2005, 363 p.
[7] Ibidem, p.121.
[8] Ibidem, p.122.
[9] Slobodan est décédé d’un infarctus du myocarde dans sa cellule du centre de détention des Nations Unies aux Pays-Bas.
[10] Le Nomos de la terre a été écrit entre 1920 et 1947.
[11] Le police bombing prend naissance dans la stratégie mise en place par le gouvernement britannique en Irak à la fin des années 20. Afin de ne pas s’engager dans un nouveau conflit terrestre imposé par la politique du Ten Years Rules (il s’agit d’une règle tacite du Parlement qui interdit toute intervention armée durant 10 années depuis la signature du traité de Versailles), les Britanniques choisissent l’emploi à outrance de la RAF pour mater la révolte irakienne, afin de maintenir leur domination sur cette région sans s’imposer la mise en place d’une lourde opération terrestre conjointe. Opus cité, p.125.
[12] Contraction des mots Global et Local.
[13] Nabil Mouline, Le Califat, histoire politique de l’Islam, Flammarion, Paris, 2016, p.4.
[14] L’auteur ne cherche pas ici à établir une comparaison entre deux menaces qui agissent contre l’ordre public, bien que les actions de l’OAS n’aient jamais été exemptes de dommages collatéraux, mais à établir le lien entre deux modus operandi.
[15] A son procès il déclare : « La violence de l’O.A.S. c’est la réponse à la plus odieuse de toutes les violences, celle qui consiste à arracher leur nationalité à ceux qui refusent de la perdre. » ;